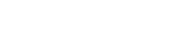Télécharger le logo
La deuxième partie de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation du traité sur les plastiques se tient actuellement à Genève, en Suisse, où plus de 170 pays se réunissent pour discuter de la mise en œuvre d’un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique. S’il est signé, ce traité réduirait les niveaux de production de plastiques à usage unique, ce qui causerait des dommages économiques considérables aux pays producteurs d’hydrocarbures, en particulier ceux d’Afrique.
La Chambre africaine de l’énergie (AEC) s’oppose fermement au projet de traité sur les plastiques. Si les intentions qui sous-tendent un tel traité peuvent découler de préoccupations environnementales dans les pays développés, sa mise en œuvre aurait des conséquences désastreuses pour l’industrie pétrochimique en Afrique. Ce traité freinerait considérablement la croissance de l’industrie pétrolière et gazière africaine, entraînant une augmentation de la précarité énergétique, un ralentissement de l’activité manufacturière, un blocage de l’industrialisation et une baisse des investissements essentiels dans le secteur chimique.
Les pays africains, en particulier le Gabon, le Ghana, l’Angola et le Sénégal, seraient les plus touchés par cet impact. Ces nations sont confrontées depuis longtemps à des défis économiques, mais elles possèdent d’importants gisements de pétrole et de gaz. Le Gabon détient 2 milliards de barils de pétrole et 1,2 billion de pieds cubes (tcf) de gaz ; le Ghana possède 1,1 milliard de barils de pétrole et 2,1 tcf de gaz ; le Sénégal 1 milliard de barils de pétrole et 120 tcf de gaz ; tandis que l’Angola possède 9 milliards de barils de pétrole et 11 tcf de gaz.
Ces ressources promettent de redresser l’économie africaine, principalement grâce aux opportunités offertes par la production pétrochimique. L’essor de l’industrie pétrochimique en Afrique s’accompagne d’une vague d’avantages économiques, allant des opportunités d’emploi à l’introduction de matériaux essentiels et de chaînes d’approvisionnement, en passant par le commerce mondial et l’innovation. La pétrochimie sera un catalyseur du développement dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l’agriculture et les transports. Confrontée à une crise énergétique et alimentaire, l’Afrique a besoin de la pétrochimie pour améliorer les conditions de vie et garantir une croissance inclusive.
En s’opposant au traité sur les plastiques, les pays africains peuvent protéger leur chemin vers la sécurité énergétique, la croissance industrielle et la prospérité économique. Le Gabon, par exemple, fait des progrès significatifs vers la réduction de la pauvreté énergétique grâce à des investissements dans des projets pétroliers et gaziers. Avec un objectif de 220 000 barils par jour (bpj), le pays cherche à diversifier son économie en développant la pétrochimie et le traitement du GNL et du GPL. Parmi les projets majeurs figurent le terminal GNL de Cap Lopez, d’un coût de 2 milliards de dollars, qui sera mis en service en 2026, l’usine de GPL de Batanga et la raffinerie SOGARA, qui vise une production de 1,5 million de tonnes d’ici 2030.
Le traité sur les plastiques perturberait cette croissance et aurait un impact sur les efforts du Gabon pour renforcer son économie. Les projets pétroliers et gaziers en cours au Sénégal seraient également compromis par le traité. Après le démarrage des opérations du projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA) en 2025 et du champ pétrolier de Sangomar en 2024, le Sénégal poursuit ses efforts pour améliorer la sécurité énergétique nationale, faciliter le développement de nouvelles industries et stimuler le développement économique. Le projet GTA a une capacité de 2,3 millions de tonnes par an (mtpa), qui sera portée à 5 mtpa lors des phases suivantes. Sedin Engineering prévoit de construire une raffinerie et une usine pétrochimique dans le pays afin de tirer parti des ressources offshore pour produire des plastiques et des produits chimiques à forte valeur ajoutée. Le traité sur les plastiques limiterait ces activités.
Par ailleurs, l’ambitieux projet de parc pétrochimique du Ghana serait gravement affecté, ce qui compromettrait le développement industriel du pays. Le pays prévoit de développer un pôle pétrolier de 12 milliards de dollars à Jomoro qui, une fois toutes les phases achevées, comprendra trois raffineries de 300 000 bpj, cinq usines pétrochimiques, des installations de stockage et des infrastructures portuaires. Le traité sur les plastiques aurait un impact sur ce projet, qui pourrait améliorer considérablement la sécurité énergétique et alimentaire dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest. L’Angola, deuxième producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, prévoit d’accroître sa production pétrochimique dans le cadre de ses efforts pour diversifier son économie dépendante du pétrole. Dans le cadre du Plan directeur pour le gaz, qui vise à attirer 30 milliards de dollars d’investissements et à générer plus de 150 milliards de dollars de retombées économiques grâce au secteur du gaz naturel, l’Angola entend renforcer sa production pétrochimique et d’engrais, soutenant ainsi la création de nouvelles industries. Le traité sur les plastiques pourrait entraîner une baisse spectaculaire de la demande de pétrole, de gaz et de plastique, ce qui aurait un impact sur les progrès de l’Angola en matière de diversification et de croissance économique.
La Tanzanie, qui possède plus de 57 tcf de réserves de gaz, poursuit également plusieurs projets pétrochimiques et gaziers. Grâce au développement du projet Tanzania LNG, d’un montant de 42 milliards de dollars, le pays cherche à accélérer son industrialisation et à se positionner comme une plaque tournante mondiale pour le pétrole, le gaz et les produits dérivés. Des projets tels que le complexe Mbolea and Petrochemicals Company Kilwa en Tanzanie, qui vise une capacité de 3,8 millions de tonnes par an, sont essentiels à la réalisation de cet objectif. Une fois achevée, l’usine sera la plus grande usine de fabrication d’engrais en Afrique, produisant une variété de produits pétrochimiques, notamment de l’urée et de l’ammoniac. Le complexe devrait entrer en service commercial en 2028, mais si le traité sur les plastiques est signé, cela pourrait avoir un impact significatif sur la capacité du projet à obtenir un financement et à être mené à bien.
« L’AEC appelle les pays africains, en particulier le Gabon, le Ghana, l’Angola et le Sénégal, à rejeter ce traité. Nous exhortons ces pays à donner la priorité à leurs besoins énergétiques et industriels plutôt qu’à des programmes environnementaux externes qui ne correspondent pas aux priorités de développement de l’Afrique. Soutenir ce traité reviendrait à se tirer une balle dans le pied, ce qui n’a aucun sens pour l’avenir de l’Afrique », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l’AEC.
Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.